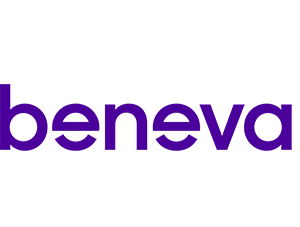Voiture électrique : les mythes déboulonnés

Contenu partenaire
Le domaine de la voiture électrique se développe à vive allure et offre de nombreux avantages encore méconnus en raison de fausses croyances qu’on décortique ici.
La voiture électrique et son potentiel gagnent à être connus. Encore récente sur le marché comparativement à son équivalent à essence, elle est l’objet de nombreux mythes qui persistent, même une douzaine d’années après la sortie des premières générations. Avec l’abondance des informations qui circulent, comment démêler le vrai du faux ? L’heure juste permet de faire un choix éclairé.
MYTHE 1
Le véhicule électrique n’est pas adapté aux hivers québécois
Tous les automobilistes redoutent le pire : une voiture qui ne démarre pas quand la température chute. Le véhicule à essence peut en effet faire défaut, mais le portrait est bien différent lorsque le moteur mise sur l’électricité. D’abord, on ne démarre pas la voiture, on « l’allume ». Plus qu’un choix de mot, cette terminologie illustre la différence fondamentale entre les deux types d’automobiles. La voiture électrique possède un moteur qui répond instantanément même par temps froid, car aucun liquide n’est en contact avec les éléments. Elle se compare à une lumière extérieure : dès l’action de l’interrupteur, elle s’allume aussitôt, indépendamment des saisons.
Les froids hivernaux entraînent néanmoins un changement de la densité de l’air qui affecte les véhicules, toutes catégories confondues. L’air froid offre une plus grande résistance et augmente ainsi la dépense énergétique, que celle-ci se traduise en énergies fossiles ou en électricité. Il faut donc s’attendre à une diminution de l’autonomie de la voiture électrique. Pour une Nissan Leaf, par exemple, l’autonomie passe de 200 km à 160 ou 140 km entre l’été et l’hiver lors de températures saisonnières normales. L’autonomie d’un modèle est donc établie par les fabricants selon une moyenne annuelle.
Bien qu’efficace, le chauffage se révèle quant à lui parfois énergivore : c’est le cas pour tous les véhicules, même ceux à essence. La voiture électrique offre toutefois un avantage de taille : le préchauffage. Branché à la borne de la maison, le véhicule peut réchauffer l’habitacle sans utiliser la batterie. Sur la route, il ne reste plus qu’à maintenir la température désirée, une stratégie qui réduit la consommation énergétique.
MYTHE 2
Il est difficile ou impossible de réaliser de longs trajets avec le véhicule électrique
Pour les trajets plus longs, la recharge de la voiture électrique devient-elle problématique ? C’est la question légitime que se posent plusieurs personnes, notamment à l’approche du temps des fêtes qui implique parfois de parcourir de longues distances pour visiter ses proches. Cette crainte est si commune qu’elle porte un nom, le « syndrome de la recharge ». Or, un sondage pour Mobilité électrique Canada note qu’au moins trois Canadiens sur quatre méconnaissent l’étendue du réseau de bornes et sous-estiment l’autonomie des voitures électriques. Dans les faits, le Québec est doté d’un important réseau alimenté par Hydro-Québec : le Circuit Électrique. Accessible 24/7, celui-ci s’étend à travers le Canada et les États-Unis. D’autres réseaux complètent l’offre au pays, comme FLO, Tesla, ChargePoint, Pétro-Canada ou RechargÉco.
Le Québec dénombre à ce jour 4 200 sites de recharge (qu’on peut comparer à une station-service) et plus de 9 600 bornes publiques (l’équivalent de la pompe). Elles sont principalement implantées dans la partie sud, où s’effectue la majorité des déplacements, mais elles sont appelées à se multiplier pour que le Québec puisse respecter sa cible d’interdiction de vente de véhicules à essence neufs à compter de 20351. Considérant que la province compte pour le moment 270 000 véhicules électriques sur ses routes, ce ratio se montre avant-gardiste et prometteur. Le Québec propose plus du tiers de l’offre de recharge dans tout le Canada. En parallèle, l’autonomie des véhicules s’est grandement développée dans les dernières années. La moyenne d’autonomie des véhicules 100 % électriques en vente au Québec se chiffre maintenant à 439 km, soit la distance aller-retour entre Québec et Saguenay.
MYTHE 3
La voiture électrique est moins durable que celle à essence
La mécanique du véhicule électrique est simplifiée par rapport à celle du véhicule à essence. Le premier ne compte qu’une vingtaine de pièces en mouvement pour son moteur contre 2 000 pour le modèle à essence. La voiture électrique est dépourvue des pièces qui sont le plus souvent problématiques pour le véhicule à essence (courroies, filtres, bougies, pot d’échappement, liquide de refroidissement, etc.). Les risques de bris sont donc réduits et l’entretien, minimisé, d’autant plus que le véhicule électrique ne requiert aucun changement d’huile.
La durabilité des véhicules électriques se mesure principalement selon la durée de vie de la batterie, garantie 8 ans par la plupart des fabricants mais pouvant aller jusqu’à 10 à 15 ans, résume le programme Roulons électrique2, une initiative d’Équiterre. Au printemps dernier, dans un article du Protégez-vous, on rappelait qu’à ce jour, les premiers véhicules électriques semblent avoir une durée de vie supérieure au cycle de vie moyen des véhicules légers au Canada, qui se situe entre 8 et 10 ans. Une certaine dégradation sera observable au cours de cette période, mais elle se produira très lentement et n’affectera pas la performance. Après 14 ans, l’autonomie d’une Leaf passerait ainsi de 160 à 110 km3. Reccurent, un site américain qui promeut la vente et l’achat de véhicules usagés, a d’ailleurs remarqué que la probabilité de devoir remplacer une batterie est inférieure à 1 % pour les modèles construits à compter de 2016.
MYTHE 4
Inutile d’acheter un véhicule électrique pour parcourir de courtes distances
Même pour une personne qui ne roule qu’à proximité de la maison, l’utilisation du véhicule électrique en vaut la peine. Il s’agit d’une option parfaite pour faire les courses au quotidien, reconduire les enfants à la garderie ou à l’école lorsqu’on ne peut se déplacer en transport en commun, à pied ou à vélo. Il permet de réaliser des économies car le coût énergétique pour faire rouler ce véhicule est moindre que celui à essence (environ 13,95 $ d’économie pour 100 km4). Comme la recharge peut toujours être faite à la maison avec des doses plus fréquentes et moins longues, la logistique s’en trouve simplifiée. Pas besoin de prendre le temps d’arrêter dans une station pour faire le plein ou d’avoir une batterie pleine avant de quitter le domicile.
Les voitures électriques bénéficient en outre d’un système avantageux par rapport aux modèles à essence : le freinage régénératif. Il permet de recharger la batterie en tirant profit de la puissance de freinage. Autrement dit, l’énergie cinétique qui serait sinon perdue est reconvertie en énergie électrique, une belle occasion de diminuer la consommation. Cette particularité devient encore plus pratique dans le cas d’une conduite urbaine qui nécessite de nombreux arrêts et ralentissements.
MYTHE 5
La batterie ne se recycle pas
La batterie ne passe pas du véhicule à la poubelle. Elle agit d’abord comme batterie de traction dans le véhicule, et ce pour au moins de 10 à 15 ans, voire plus. Elle peut ensuite être réutilisée en tant que batterie stationnaire. Les batteries aux ions de lithium accumulent l’énergie et peuvent donc être employées dans un nouveau contexte pour accumuler l’énergie renouvelable, qu’elle soit solaire ou éolienne. Les entreprises l’apprécient, incluant les constructeurs automobiles qui redonnent ainsi une deuxième vie aux anciennes batteries. Ce second souffle peut durer de 10 à plus de 20 ans. Finalement, le cycle se complète avec le recyclage des matériaux. Au Québec, 95 % des matériaux qui la composent sont recyclables à l’infini et peuvent donc produire de nouvelles batteries. C’est le cas du lithium, du nickel, du manganèse, du cobalt, du graphite, du cuivre et de l’aluminium. Lorsqu’on connaît bien les qualités innovantes de la voiture électrique et le contexte favorable à l’extension du réseau électrique, ce type de véhicule représente une option intéressante à bien des égards, non ?
2 « Choisir un véhicule rechargeable qui répond à vos besoins », Roulons électrique, 2024, p. 18.
3 « Informations générales », Association des véhicules électriques du Québec.
4 « Choisir un véhicule rechargeable qui répond à vos besoins », Roulons électrique, 2024, p. 12.
Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d’assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 500 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s’ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25,2 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l’industrie de l’assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est situé à Québec.
Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.