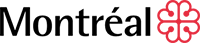Le budget participatif, un outil démocratique pour façonner l’avenir de Montréal

Contenu partenaire
Pour la troisième fois, la population montréalaise, dans toute sa diversité, est invitée à voter en février et en mars pour les projets qu’elle souhaite voir se concrétiser dans le cadre du budget participatif de la Ville de Montréal. Une occasion unique de s’exprimer et de contribuer activement à la mise en place d’aménagements visant à améliorer la sécurité des déplacements, à favoriser l’équité entre les quartiers et à répondre aux attentes des générations futures.
Né en 1989 à Porto Alegre, au Brésil, le processus de budget participatif s’est rapidement répandu à l’échelle mondiale et est arrivé au Canada au début des années 2000. Au Québec, l’arrondissement du Plateau Mont-Royal à Montréal a mené le premier budget participatif en 2006 et Saint-Basile-le-Grand a été la première municipalité à adopter cet outil démocratique en 2014. Depuis, de nombreuses villes ont suivi, à commencer par Montréal, qui en est aujourd’hui à sa troisième édition du budget participatif. Ce dispositif contribue à revitaliser la démocratie en encourageant une participation citoyenne plus directe et en redonnant une véritable voix à la collectivité. Le pouvoir démocratique ne se limite plus aux élections, qui ont lieu tous les quatre ou cinq ans, mais s’exerce désormais de manière continue.
Le fonctionnement du budget participatif est simple. Dans un premier temps, les citoyennes et les citoyens soumettent leurs propositions de projets qu’ils désirent voir se réaliser portant sur diverses thématiques. Ensuite, des comités mixtes — composés de membres de la société civile et de fonctionnaires municipaux — sélectionnent les idées à favoriser. Après une analyse de leur faisabilité technique, réglementaire et financière, les projets retenus sont soumis au vote de la population, qui détermine ainsi l’affectation d’une partie du budget municipal. « C’est relativement rare, dans notre système démocratique, qu’on donne à la population le choix définitif pour ce type de décision », souligne Elisabeth Rivest, conseillère en expérience citoyenne à la Ville de Montréal.
S’adapter aux besoins du terrain
En pratique, le budget participatif dépasse largement le cadre d’une simple consultation budgétaire. Il vise à intégrer la participation citoyenne dans le choix des projets d’aménagement et d’équipements municipaux, afin d’améliorer concrètement la qualité de vie locale. Le budget participatif permet ainsi de réintroduire cette dimension locale dans le processus décisionnel. Toutes les citoyennes et tous les citoyens, quels que soient leur origine et leur parcours, sont invités à façonner une ville et des projets qui leur ressemblent.
La première édition du budget participatif (2020-2021) a permis de mobiliser un budget de 25 millions de dollars pour financer des initiatives destinées à accompagner la transition écologique et sociale de Montréal. Parmi les 12 projets lauréats, celui des microforêts, inspiré par le botaniste japonais Akira Miyawaki, a reçu un large soutien citoyen. Il a conduit les arrondissements de Montréal-Nord, Outremont, Pierrefonds-Roxboro, Rosemont–La Petite-Patrie et Verdun à se concerter dans le but d’implanter plus de 6500 arbres et arbustes. À ce jour, 15 microforêts ont déjà été aménagées ou sont en voie de l’être, créant des espaces de ressourcement pour la population et des îlots de biodiversité pour la faune et la flore locales.
 Photo: Mathieu Sparks
La réalisation du projet Quai 34 est en cours dans l’arrondissement de Lachine.
Photo: Mathieu Sparks
La réalisation du projet Quai 34 est en cours dans l’arrondissement de Lachine.
D’autres projets ambitieux ont vu le jour après la première édition du budget participatif. C’est le cas du Quai 34, qui s’est donné pour mission de transformer un ancien espace de stationnement en un lieu de vie accessible, écologique et propice à la détente à Lachine. À côté de ce type de projet d’aménagement spectaculaire, des initiatives répondant à des besoins plus fondamentaux ont été lancées en parallèle. Le programme De l’eau dans ta gourde a notamment rassemblé six arrondissements pour l’installation de plus de 125 fontaines d’eau et de dispositifs permettant de remplir des bouteilles réutilisables.
 Photo: Marius Gellner
Le programme De l’eau dans ta gourde a rassemblé six arrondissements pour l’installation de plus de 125 fontaines d’eau et de dispositifs permettant de remplir des bouteilles réutilisables.
Photo: Marius Gellner
Le programme De l’eau dans ta gourde a rassemblé six arrondissements pour l’installation de plus de 125 fontaines d’eau et de dispositifs permettant de remplir des bouteilles réutilisables.
Un budget à la hausse
Forte du succès de la première édition, qui a amené plus de 20 000 citoyens à voter, la Ville de Montréal a alloué 31,5 millions de dollars à la deuxième fournée du budget participatif (2022-2023). Cela a permis de financer cinq nouveaux projets répondant, entre autres, aux attentes des jeunes Montréalais, avec la création de microparcs, de microplaces et de gyms de quartier en plein air. Lancée en 2024, la troisième édition du budget participatif bénéficie d’une enveloppe encore plus importante, soit 45 millions de dollars. Son objectif est d’élargir la participation citoyenne pour mieux satisfaire les besoins de la population montréalaise, tout en poursuivant la transition socioécologique entamée lors de la première édition.
Un budget d’au moins 10 millions de dollars a été spécialement alloué à la réalisation de projets concernant la jeunesse, l’une des trois priorités de cette troisième édition, aux côtés de l’équité et de la sécurité. La population a été invitée à soumettre des propositions visant à répondre aux attentes des moins de 30 ans, à garantir un accès équitable aux infrastructures municipales pour toutes et tous, et à créer des milieux de vie plus sûrs, en sécurisant les déplacements, en luttant contre la violence, ou en protégeant la population contre les aléas climatiques. Parmi les 880 idées collectées, 519 ont été jugées admissibles selon les principaux critères de recevabilité.
Une vision élargie
Par la suite, 150 propositions ont été retenues et mises en priorité afin de développer près de 67 projets. Ceux-ci ont ensuite été analysés par les arrondissements et les services de la Ville pour évaluer leur faisabilité, permettant de retenir près d’une quarantaine de projets à soumettre au vote. La valeur des projets varie de 500 000 $ à 10 millions de dollars. « Il y a un véritable processus pour intégrer les idées proposées par les citoyennes et les citoyens dans la planification de la Ville de Montréal. C’est à la fois un travail considérable en interne et un programme dont nous sommes extrêmement fiers », explique Fannie Pilon-Millette, conseillère en expérience citoyenne. À l’aube de voter pour les projets finalistes de cette troisième édition, les Montréalaises et les Montréalais se voient offrir une formidable occasion de façonner une métropole qui reflète encore davantage les aspirations de sa population.
« C’est une manière de transformer un quartier et de dire à la Ville : investissez dans ce type de projet », souligne Mme Pilon-Millette. C’est aussi l’occasion d’élargir son regard au-delà de sa propre rue, voire de son arrondissement. « Une personne vivant à Rosemont, où elle a accès à de nombreuses infrastructures, peut choisir de soutenir le projet de réfection d’un parc à Montréal-Nord, poursuit-elle. Lors des deux premières éditions, les résultats des votes ont montré que les Montréalaises et Montréalais étaient sensibles aux besoins des autres. Il ne s’agit pas seulement de répondre à leurs propres besoins, mais aussi de penser à ce qui améliorerait la vie de leurs voisins. »
 Photo: Arbre Évolution
Réalisation d’une microforêt dans l’arrondissement d’Outremont
Photo: Arbre Évolution
Réalisation d’une microforêt dans l’arrondissement d’Outremont
Des collaborations fructueuses
Le budget participatif ne se limite pas à donner à la population montréalaise une voix dans l’aménagement des espaces publics. Il stimule aussi la créativité au sein de la municipalité en encourageant la collaboration entre les différents services administratifs de la Ville. Un bel exemple de cette synergie a été le projet De l’eau dans ta gourde, lancé lors de la première édition, et qui a réuni les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Outremont, Saint-Léonard et Ville-Marie autour d’un objectif commun. « C’est la première fois qu’on a eu six arrondissements qui se sont assis ensemble afin de planifier un achat groupé pour ce type d’équipement, se félicite Fannie Pilon-Millette. Ce projet a permis de rassembler des arrondissements qui n’ont pas forcément l’habitude de collaborer. »
Les microforêts de Montréal illustrent également cette dynamique collaborative. Les arrondissements de Montréal-Nord, Outremont, Pierrefonds-Roxboro, Rosemont–La Petite-Patrie et Verdun ont uni leurs efforts pour réfléchir à la meilleure manière de réaliser ce projet novateur, ce qui a donné naissance à une vraie communauté d’aménagistes de microforêts échangeant leurs savoirs et pratiques entre arrondissements. « Lorsqu’on est aménagiste dans un arrondissement, on est souvent le seul à occuper ce rôle, explique Elisabeth Rivest. Avoir l’occasion, grâce aux microforêts, de rencontrer ses homologues d’autres arrondissements permet de créer un véritable réseau de professionnels. Ils partagent leurs expériences, s’encouragent mutuellement et favorisent ainsi une collaboration transversale. »
Parole à la jeunesse !
Avec une dotation d’au moins 10 millions de dollars consacrée à des projets répondant aux aspirations des moins de 30 ans, les jeunes générations occupent une place centrale dans cette troisième édition du budget participatif. « Ils représentent notre public cible, tout comme les personnes qui sont davantage éloignées des processus participatifs », souligne Elisabeth Rivest. Dès le lancement de la phase d’appel aux idées, des ateliers d’idéation ont été organisés pour encourager les jeunes à soumettre des propositions de projets qui les touchent directement.
« Pour la phase de vote à venir, nous allons également nous rendre dans quelques écoles et organismes pour les inviter à voter», confie Mme Rivest. La conseillère a aussi travaillé au développement de trousses d’autoanimation de séances de vote en étroite collaboration avec le Centre d’écologie urbaine et l’Institut du Nouveau Monde (INM), dont la mission est d’accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. Ces outils précieux, à télécharger dès le mois de janvier, sont destinés à accompagner le personnel éducatif et les acteurs du monde communautaire dans l’organisation de discussions autour des projets du troisième budget participatif.
« L’objectif est de réapprendre à délibérer de manière constructive avant de passer à l’exercice du vote individuel, explique Elisabeth Rivest. Nous avons cinq semaines de vote, entre février et mars, ce qui permet d’intégrer facilement ces séances dans le cadre d’un programme scolaire. Tant dans les classes que dans les organismes communautaires, il est possible d’aborder ce grand sujet qu’est le budget participatif, afin de discuter des projets locaux, ainsi que de ceux qui concernent des territoires marqués par des inégalités et des facteurs de vulnérabilité multiples. »
Afin d’élargir la participation, notamment dans les quartiers plus difficilement accessibles, la Ville de Montréal prévoit également d’organiser des séances de vote dans les bibliothèques. Le calendrier de ces événements est à retrouver sur montreal.ca.
Guide pratique pour voter au budget participatif
Qui peut voter ?
- Toute personne de 12 ans et plus résidant à Montréal
- Les commerçants et commerçantes de Montréal
- Les Montréalaises et les Montréalais des 19 arrondissements de la Ville
- Aucune exigence de citoyenneté canadienne pour participer au vote
Comment voter ?
- Le vote se déroule sur le site Internet de la Ville en février et en mars 2025
- Chaque participant doit s’engager à voter une seule fois
- Il est possible de voter pour 10 à 15 projets
- Chaque projet est présenté avec les informations suivantes : son nom, une description succincte, un lieu de réalisation et le coût estimé
Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.